Dimanche des Rameaux
(Cycle A)
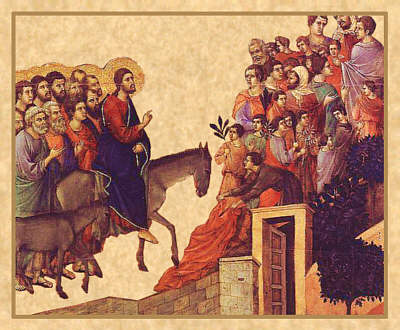
Is
50,4-7
Ph 2,6-11
Mt
26,14-27,66
La liturgie de la parole de ce dimanche, nous invite à
contempler le mystère de Jésus qui dans sa condition humaine “ Mais s’anéantit
lui-même, prenant la condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes.
S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la
mort sur une croix” (Ph. 2,7-8). L’événement de la passion et de la mort du
Seigneur, raconté et médité dans l’évangile de Matthieu, en effet, constitue aujourd’hui
le centre de la liturgie. Les deux périscopes qui précèdent le récit
évangélique nous placent dans la juste perspective de la lecture et nous offre
une clé d’interprétation.
La première lecture
(Is 50,4-7) est tirée du troisième des quatre cantiques
du mystérieux “ serviteur du Seigneur” de Deutéroisaie (cf. Is 42,1-4; 49,1-7;
52,13-53,12). Plusieurs interprétations ont été faite sur cette demande de
l’éthiopien à Philipe, se trouvant tous deux sur le chemin qui porte de
Jérusalem à Gaza: “De qui est cette prophétie, du prophète même ou d’un
autre?”. Certains auteurs pensent que le serviteur désigne le peuple d’Israël
ou une partie du peuple fidèle au serviteur de Dieu; les autres l’identifient
avec Jérémie souffrant sous le pouvoir du roi des Perses Cirons (cf 45,1); il
ne manque pas ceux qui voient dans ce cantique plusieurs serviteurs (Israël, le
reste fidèle, le prophète, etc). Dans les premières communautés chrétiennes ces
cantiques du Serviteur souffrant étaient appliqués à Jésus (cf. Mt 8,17;12,18-21;
Lc 22,37; Hch 8,32-33) et certains des grands traits de ces cantiques
s’appliquent au baptême et à la transfiguration du Seigneur. Mais aussi la
figure du Serviteur souffrant est utilisée pour parler d’Israël (Lc 1,54) ou
des disciples de Jésus (Mt 5,14.16.39; Hch 14,37; 26,17-18).
Quelque soit le cas, la figure du serviteur, est en réalité, une ébauche de Jésus-Messie qui, comme le prophète, non pas seulement annonce la parole aux abattus (Is 50,4), mais il est la Parole divine même au milieu des hommes. Le serviteur n’est pas seulement l’homme de la parole mais aussi l’homme de douleur. L’un des ses traits plus typiques, est la souffrance: il est frappé aux épaules comme un idiot, lui qui est, le sage par excellence, porte-voix de la parole; on l’entoure des mépris (insultes, des salives, arrache la barbe). Mais lui ne résiste pas au contraire il affronte avec conscience la douleur, se confiant à la protection de Dieu, dans une sécurité totale. La souffrance acquiert un sens nouveau en rapport avec la tradition, c’est la conséquence de son ministère et, paradoxalement, la preuve de son élection divine.
La deuxième lecture
(Phi 2,6-11) est un hymne poétique probablement
d’origine liturgique, même si sont possibles
d’autres analyses à ce sujet. On peut le diviser en deux strophes: (1)
2,6-8: l’humiliation du Christ et (II) 2,9-11: exaltation du Christ. La Paques
du Christ est présentée de façon nouvelle et originale à travers un mouvement
ascensionnel qui va depuis l’humiliation vers l’exaltation. L’hymne nous permet
de contempler la double figure de la Paques, faite de douleur et de gloire,
d’humiliation et de salut.
Le mystère de la passion-mort de Jésus est
l’anéantissement, “condition d’esclave”, effacement de Dieu: Le Christ, tout en
étant de “condition divine” (Ph 2,6), “ a pris la condition d’esclave et s’est
fait semblable aux hommes” (Ph 2,7;cf.2 Co 8,9). La mort sur la croix, en
effet, était l’expression suprême de l’humiliation dans le monde romain: c’est
la mort typique de l’esclave et de l’étranger. Contemporainement la
passion-mort de Jésus est un risque positif, un triomphe, une résurrection et
une glorification, salut et le “nom
divin dans la deuxième strophe de l’hymne met de façon manifeste que
l’exaltation est la réponse de Dieu à l’humiliation librement acceptée par le
Christ obéissant au Père jusqu’à la fin (2,9: pour cela Dieu l’a exalté”). Dieu
exalte son Christ (cf.3,14;8,28;12,32;Hc 2,33;5,31), à travers l’action
symbolique de la donation d’un non, un nom personnel (Jésus) qui dans son
l’humiliation jusqu’à la dans ce “titre” qui exprime la nouvelle condition du
Christ glorifié au-dessus de tous les êtres. La confirmation de ce titre ne se
réalise pas dans l’intimité avec Dieu mais au contraire en public et a comme objectif
que Jésus soit connu comme Seigneur, le Christ, qui exprime sa gloire et sa
souveraineté divine. L’obéissance du Messie-Jésus, vécu avec l’absolu liberté,
est le chemin de l’homme nouveau.
L’évangile de ce
dimanche est constitué du récit de la passion selon saint Marc (14,1-15,47). De quatre évangélistes, Marc semble être
celui qui nous raconte avec une plus grande objectivité le faits, la réalité de
la mort de Jésus sur la croix. C’est pas qu’il manque de profondeur
théologique, mais sa théologie est dans le sens que il recueille dans le
scandale de la croix la plus grande révélation de Jésus. Marc cherche de nous
faire accepter ce scandale parce que c’est seulement sur la croix que Jésus se
révèle ce qu’il est vraiment, “Le Fils de Dieu” (15,39). C’est pas pour rien
que quelqu’un à définie l’évangile tout entier de Marc est une “ apologie de la
croix”.
Dès le début de son
évangile, Marc proclame Jésus Messie (le Christ) et le Fils de Dieu (1,1). Tout
l’évangile est entendu pour faire découvrir aux premier disciples qui est Jésus
de Nazareth. Jésus lui-même refuse de dire ce qu’il est et interdit aux démons
de manifester son identité (1,25). Pierre proclame Messie (8,29), mais sa
conception de Messie ne correspond pas à ce qu’est Jésus (8,31-33). C’est
seulement à l’heure suprême de la passion que Jésus se déclare ouvertement le
Messie (14,62), le Fils de l’homme et Roi des Juifs (15,2). A présente il n’a
plus aucun risque d’être malentendu. Personne pensera qu’il s’agit de
révélation de pouvoir politique, à présent qu’on le voit condamné à la mort de
la croix. En effet, c’est seulement à ce moment, dans son anéantissement
complet sur la croix que Jésus peut être reconnu et proclamé pour ce qu’il est
vraiment, le Fils de Dieu (15,39).
Le récit commence avec l’intention des grands prêtres et
des scribes pour “ se saisir de Jésus au moyen d’une ruse” (14,1). L’occasion
propice se présente quand Juda se rend chez eux pour livrer Jésus” (14,1). Dans
ces deux affirmations claires de l’intention de tuer Jésus se trouve la scène
de l’onction de Jésus par une femme pendant la scène de Béthanie (14,3-9).
Jésus est conscient de ce qu’on est entrain de préparer pour lui et accueille
le geste de cette femme comme une anticipation de sa sépulture (14,8).
Après
avoir achevé les préparatifs nécessaires (14,12-16), ce qui donnent encore une
foi de plus le sens du fait que Jésus va en l’encontre de quelque chose
préparée avant et qu’il connaît assez bien, Jésus se met à table avec les douze
pour célébrer la pâques (14,17-25). C’est significatif que Marc place la scène
dans laquelle Jésus se donne à ses
disciples comme pain et sang rependu (14,22-24) entre l’annonce de la trahison
de Juda (14,18-21) et celui du reniement de Pierre (14,27-31).
La scène du Gethsémani (14,14,32-51), est toute centrée
sur la tristesse et la peur que Jésus éprouve devant la mort, elle s’ouvre avec
le besoin que Jésus sens de la compagnie et du soutient de siens ( 14,33) et se
conclut avec l’abandon de Jésus de la part de tous (14,50-51). Jésus,
complètement seul, après avoir accepter de boire le calice qui lui a été
présenté de la part du Père (14,36), il part de sa propre volonté à la
rencontre le traite ( en grec la parole traite est un participe du verbe
“livrer”; donc le traite est celui qui livre, une parole dense en signification
que l’on trouve neuf fois dans le récit). Jésus est pleinement lucide; il sait
que “est arrivée l’heure” (14,41). La scène du procès devant le sanhédrin
(14,53.55-65) est mise en parallèle avec celle du reniement de Pierre
(14,54.66-72). Pendant que Jésus déclare- pour l’unique fois dans tout
l’évangile- qu’il est le Messie, comme l’avait proclamait Pierre avant (8,29),
Pierre à présent nie d’être disciple parce que pour le moment il ne peut pas
accepter un Messie crucifié (voir 8,31-33). Dans le sanhédrin la déclaration de
Jésus suscite le scandale et “tous disent qu’il était le roi de mort”.
Dans ce procès romain (15,1-15) est placé au centre le
verbe “livrer” ; le sanhédrin livre Jésus à Pilate (15,1) et Pilate le livre
parce qu’il soit crucifié (15,15). Pendant ce procès Jésus se reconnaît comme
le roi des juifs. Dans le récit de l’exécution nous pouvons distingué six
moments successifs: le chemin vers Golgotha (15,21-23), la crucifixion
(15,24-28); le sanhédrin livre Jésus à Pilate (15,1) et Pilate le livre parce
qu’il soit crucifié (15,15). Pendant ce procès Jésus se reconnaît comme le roi
des juifs . Dans le récit de l’exécution nous pouvons distingué six moments
successifs: le chemin vers Golgotha (15,21-23), la crucifixion (15,24-28), la
mort (15,33-37), les répercutions de la mort de Jésus (15,38-39), la présence
des femmes (25,40-41).
Le récit de la sépulture
du corps de Jésus (15,42-47) indique la continuité entre la mort et la
résurrection. D’une part Marc parle du corps de Jésus (15,45; en grec ptome)
pour mettre en relief la réalité de sa mort; d’une autre part l’attente du
règne de Dieu (15,43) et les femmes qui étaient présentes à observer là où
était déposé Jésus (15,47). Ce sont ces mêmes femmes qui le matin de Pâques
découvriront la tombe vide et recevront les premières l’annonce de la
résurrection (16,1-6).